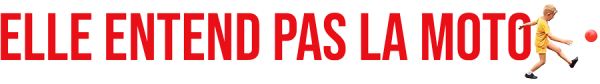À propos de la surdité en France
La surdité profonde en France aujourd’hui
Les différents modes de communication pour les personnes sourdes
Pourquoi la République a-t-elle longtemps combattu la langue des signes
Oralisme : une histoire de l’éducation sourde
Soutiens du film
La surdité profonde en France aujourd’hui
En France, aujourd’hui, 500 000 personnes souffrent de surdité profonde ou sévère (chiffres de décembre 2024)
10% de la population française a une perte auditive. Ces chiffres tendent à augmenter avec le vieillissement de la population et la démocratisation de nos usages à risque (concerts, casques et écouteurs, villes bruyantes)
Il existe 4 niveaux de perte auditive connue (légère, moyenne, sévère et profonde), la surdité profonde étant le plus avancé.
Parmi les personnes ayant une perte auditive, les jeunes de moins de 24 ans présentent le plus fort taux d’appareillage. Cependant, il faut ici distinguer le facteur génétique (naître avec des problèmes d’audition) du facteur physique (vieillissement de l’oreille – aussi appelé presbyacousie).
Qu’est-ce que la surdité profonde ?
On considère qu’une personne est atteinte de surdité profonde lorsque l’on constate une perte auditive entre 91 et 119 décibels qui peut se faire sur une (unilatérale) ou les deux oreilles (bilatérale). Les troubles majeurs dans la communication : plus aucune perception de la parole, seuls les sons très puissants sont entendus (feu d’artifice, avion…).
Surdité profonde : La perte de l’audition est irréversible ?
Devenir sourd est un problème de santé qui n’est pas forcément irréversible. Il existe de nombreuses solutions aujourd’hui pour pallier la déficience auditive comme une intervention chirurgicale, en cas d’atteinte des osselets ou de tumeur sur le nerf auditif.
Même dans le cas où la baisse d’audition est liée à l’âge ou à une maladie dégénérative, et que l’on sait que la perception des décibels va s’atténuer, de nombreuses possibilités médicales permettent de soutenir les patients atteints de surdité profonde.
Pour les enfants touchés dès la naissance par une atteinte du nerf auditif, la pose d’implants cochléaires permet de les plonger dans un bain sonore dès le plus jeune âge de la vie. Par la suite, il leur est possible d’apprendre la langue des signes pour faciliter la communication avec leurs proches. Des appareils auditifs adaptés sont une bonne alternative à l’implant cochléaire chez un enfant ou un adulte touché par une perte auditive sévère à profonde…
Ces appareillages, qui se présentent sous la forme de contours d’oreille pour les plus puissants, redonnent à la personne une vie sociale et professionnelle plus aisée, même dans des professions où la communication est essentielle, comme le service, les soins ou l’enseignement. Dans tous les cas, en parler à son entourage permet d’éviter les incompréhensions, et d’aménager les temps d’échanges si besoin (sous-titrages, microphone confié à l’orateur…).
Quelles sont les causes de la surdité profonde ?
La surdité profonde peut avoir plusieurs origines. On distingue la surdité de transmission, liée à un trouble du tympan ou de l’oreille moyenne (souvent à cause d’une otite ou d’une obstruction), et la surdité de perception, qui touche l’oreille interne, le nerf auditif ou la cochlée : dans ce cas, les sons sont entendus mais mal compris.
Cette dernière peut être causée par des médicaments ototoxiques, des maladies dégénératives, ou surtout par des traumatismes sonores (exposition prolongée à un bruit supérieur à 80-90 décibels). Une surdité mixte combine ces deux types, comme dans la presbyacousie, liée à l’âge.
Les sons voyagent à travers l’oreille externe, moyenne, puis interne, où ils deviennent signaux électriques. Si une lésion survient à un de ces niveaux, la transmission est altérée. Chez l’enfant, une surdité non détectée peut affecter le langage : le dépistage et l’appareillage précoce sont essentiels. Chez les adolescents, la prévention est primordiale :
une exposition prolongée à un son trop fort peut endommager durablement l’audition.
Les différents modes de communication pour les personnes sourdes
La LSF (Langue des Signes Française) est une langue à part entière, avec sa propre grammaire et sa propre syntaxe. Chaque signe résulte de la combinaison simultanée de plusieurs éléments : forme et orientation de la main, position dans l’espace, direction du mouvement, et expressions du visage. Contrairement à une idée reçue, la langue des signes n’est pas universelle : ancrée dans l’environnement et la culture, elle varie selon les pays, voire les régions (Langue des Signes Allemande, Québécoise, etc.). Longtemps ignorée, la LSF n’est reconnue comme langue officielle en France que depuis 2005. Depuis 2007, elle peut être choisie en option au baccalauréat général et technologique.
L’oralisation désigne le fait, pour une personne sourde, de s’exprimer verbalement. Cette méthode, historiquement imposée lorsque la LSF était interdite, vise l’apprentissage de la langue orale. Si elle facilite la communication avec les entendants, notamment dans le monde professionnel, elle reste un exercice complexe pour la personne sourde.
La lecture labiale consiste à lire sur les lèvres. Elle ne permet de comprendre qu’environ 40 % du message et nécessite un apprentissage auprès d’un orthophoniste. Comme l’oralisation, elle demande un effort intense et s’avère très fatigante sur la durée.
Le langage parlé complété, à ne pas confondre avec la LSF, est une méthode destinée aux enfants oralisant. Il associe à chaque syllabe prononcée un geste visuel correspondant, qui rappelle la façon de la prononcer. Ce système vient compléter la parole pour en améliorer la compréhension.
Les pictogrammes permettent de rendre un message écrit plus visuel. Très codifiés, ils peuvent à eux seuls transmettre l’information aux personnes peu à l’aise avec l’écrit. Ils sont notamment utilisés dans l’apprentissage du français écrit chez les enfants sourds.
Pourquoi la République a-t-elle longtemps combattu la langue des signes
Différente de la grammaire française, la langue des signes possède sa propre grammaire. Mais pourquoi, en 1880, lors d’un congrès international donné à Milan, fut-il décidé que l’oralisme devait s’imposer au détriment de la langue des signes ?
En 1771, Charles-Michel de L’Épée, appelé “l’Abbé de L’Épée”, a créé la première institution éducative gratuite pour les sourds de France à Paris. L’institut des Enfants Aveugles fut fondé 15 ans plus tard par Valentin Haüy. Au cours de la Révolution française, ces deux organismes furent placés sous la protection de l’État et leurs fondateurs furent reconnus comme les dépositaires de méthodes pédagogiques considérées comme universelles. L’abbé de L’Épée mit au point le langage des signes pour les sourds, et Valentin Haüy initia une méthode de lecture au service des aveugles qui fut développée au 19e siècle par Louis Braille, pour donner l’alphabet qui porte son nom.
La langue des signes, une histoire conflictuelle avec les «oralistes»
Le système d’écriture tactile à l’usage des personnes aveugles a été constamment perfectionné pour s’adapter aux évolutions des modes de communication, notamment depuis la révolution de l’informatique. Mais l’histoire du langage des signes a été beaucoup plus conflictuelle. Dès le 18e siècle, cette méthode de communication proposée aux sourds fut contestée par les «oralistes». Considérant que la langue des signes n’était pas une vraie langue, ils estimaient que les sourds devaient apprendre à parler pour pouvoir s’intégrer dans la société. Bien que l’oralisme ait fait son entrée à la Faculté de médecine dès 1800, ses partisans furent marginalisés jusqu’au début de la IIIe République. Mais lors d’un fameux congrès international, qui eut lieu à Milan en 1880, il fut décidé que les méthodes d’enseignement oral devaient s’imposer au détriment de la langue des signes. Ce congrès, organisé à l’initiative des «oralistes», réunit plus de 255 participants. Mais seuls trois sourds étaient présents et aucun interprète n’avait été prévu pour eux. L’argument principal qui s’imposa pour justifier l’abandon de la langue des signes était que cette langue ne pouvait exprimer des idées abstraites. En réalité, la majorité des congressistes estimaient que les sourds n’avaient pas les mêmes droits à l’éducation que les autres enfants. Voilà pourquoi leur objectif pédagogique était d’oraliser plutôt que de transmettre des connaissances.
Le “réveil sourd”, un mouvement pour le droit à la différence
Des raisons politiques expliquent aussi ce basculement dans l’oralisme. La langue des signes subit le même sort que les langues régionales à une époque où les États multipliaient les mesures pour uniformiser la langue nationale. Dès la rentrée d’octobre 1880, le gouvernement français s’empressa d’imposer la méthode orale dans la majorité des écoles spécialisées. Les établissements pratiquant la langue des signes furent fermés ou contraints de s’adapter et les enseignants sourds furent licenciés. Il fallut attendre près d’un siècle pour que les mouvements plaidants pour le droit à la différence impulsent ce qu’on a appelé le «réveil sourd». Les revendications en faveur de la langue des signes furent prises en compte en 1991 quand le gouvernement français reconnut officiellement le droit au bilinguisme. Mais il fallut attendre la loi du 11 février 2005 pour que soit supprimée l’obligation de la méthode orale. À partir de cette date, les sourds eurent le droit de bénéficier d’une éducation en langue des signes dans n’importe quelle école en France.
Textes issus du Podcast de France Culture «Le Pourquoi du Comment» du 12/11/2023
Oralisme : une histoire de l’éducation sourde
Pour comprendre l’Histoire des sourds, il est important de parler de l’oralisme, qui est une méthode pour enseigner la langue orale aux sourds. On parle d’oralisation pour la capacité de la personne sourde à s’exprimer verbalement.
Entre oralisme et langue des signes, c’est une vieille histoire. Une vieille rancœur. Cette “bataille” historique a toujours poussé la supériorité des langues orales. L’oralisme facilitait l’intégration, tandis qu’utiliser le geste plaçait les sourds du côté de l’animal et du péché.
Histoire des tendances d’apprentissage
On pensait que les Sourds ne pouvaient pas apprendre. L’histoire de l’éducation des Sourds est donc récente.
• L’abbé de l’Épée ouvre en 1760, à Paris, la première école « pour les enfants sourds de toutes conditions » (aujourd’hui l’Institut Saint-Jacques) subventionnée par des bourses de l’Etat.
• Vers le milieu du XIXe siècle, le nombre d’écoles pour sourds augmente très vite en France, passant d’une vingtaine en 1820 à 70 en 1901. Mais des voix puissantes s’élèvent contre la Langue des signes, accusée par les entendants d’isoler les sourds et de les replier sur eux-mêmes. Or, “l’école pour tous“ demande de travailler avec les mêmes techniques, au détriment des langues minoritaires comme la LSF.
• En 1880, le Congrès de Milan bannit la Langue des signes au profit de « la méthode orale.
• La standardisation de l’apprentissage aboutira à la loi Jules Ferry (1882).
• De nouvelles méthodes oralistes naissent : en 1955, la méthode verbo-tonale utilise les restes auditifs et s’appuie sur la perception vibro-tactile.
• En 1966, le Langage Parlé Complété (LPC), est introduit comme complément à la lecture labiale.
L’oralisme, une demande appuyée par les parents ?
De nombreux essais se sont penchés sur l’influence qu’ont eu les parents d’enfants sourds sur la prédominance de l’oralisation.
Graham Bell, fils d’une mère devenue sourde après avoir contracté la scarlatine, épousa une femme devenue sourde. Son obsession pour l’oralisation (mouvement moraliste) et pour parvenir à faire entendre sa voix à son épouse, le mena à inventer le téléphone.
Édouard Seguin, dans un texte sur le pro-oraliste Jacob Pereire, parle du chagrin d’une mère qui s’inquiète de ne pas faire parvenir « avec les battements de son cœur, la voix de son amour » à son enfant sourd. Il l’encourage à utiliser d’autres formes de contacts, comme ses lèvres et les vibrations de sa poitrine, pour lui montrer son amour.
Il semble que la surdité et l’incapacité à communiquer avec une personne que l’on aime par la voix, fasse glisser la parole vers un dérivé de l’affectivité et de l’amour. Une façon de “stigmatiser” un manque (la voix des entendants qui n’est pas perçue). Dans “History of Deaf Education”, Louis Neethling retrace dans un documentaire-fiction les méthodes d’autrefois pour enseigner l’oralisme.
Texte de Marie-Charlotte Bixquert extrait du dossier de presse du film J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd de Laetitia Carton
Un film soutenu par
La Fondation pour l’audition
Reconnue d’utilité publique depuis 2015, la Fondation Pour l’Audition œuvre au quotidien pour faire avancer la cause de l’audition et des surdités.
Elle soutient la recherche scientifique et médicale, éveille les consciences, brise les tabous et change le regard porté sur les sourds, les malentendants et leurs proches.
« Ce film propose un témoignage fort sur la résilience de Manon et de sa famille, explorant les défis liés à l’intégration des personnes sourdes ou malentendantes dans une société encore insuffisamment attentive à leurs besoins spécifiques. À travers ce récit intime, la Fondation souhaite sensibiliser largement le public, favoriser des échanges et renforcer la compréhension collective des enjeux d’inclusion et d’accompagnement des familles concernées par les surdités. »
En savoir plus sur les actions au quotidien de la FONDATION : fondationpourlaudition.org
L’Association nationale pour l’audition
L’Association Nationale de l’Audition (ANA) est une association loi 1901 à but non lucratif, reconnue d’intérêt général. Elle est un acteur de référence en France dans la prévention des risques auditifs, la lutte contre le renoncement aux soins et les discriminations sous toutes ses formes.
Elle organise son action autour de 4 actions phares : organisation des campagnes nationales d’information et de dépistages ; l’appui aux professionnels relais sur l’ensemble du territoire ; la réalisation d’études et de baromètres ; le plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour le développement d’une politique active de prévention primaire.
« Soutenir le film ELLE ENTEND PAS LA MOTO est apparu évident tant les parcours de vie de Manon, et de sa famille mettent en lumière l’importance de la confiance en l’individu au-delà de son apparence, de sa différence, des marqueurs de son handicap. Le film rappelle à chacun que la voie pour une société inclusive et plus juste est sous nos yeux. Il nous suffit de la saisir pour une réelle société sans frontières. »
En savoir plus sur les actions au quotidien de l’association : association-nationale-audition.org